 Les représentations, qu'elles soient individuelles ou bien collectives à l'échelle d'un groupe
de personnes ou d'une organisation font largement appel à la notion d'apprentissage. Cependant, elle ne prennent
pas assez en compte l'aspect interactif des relations interpersonnelles donc la dynamique du processus par lequel
l'individu, le groupe ou l'organisation acquièrent une compréhension de leur comportement et du contexte,
chacun à son niveau d'intégration.
Les représentations, qu'elles soient individuelles ou bien collectives à l'échelle d'un groupe
de personnes ou d'une organisation font largement appel à la notion d'apprentissage. Cependant, elle ne prennent
pas assez en compte l'aspect interactif des relations interpersonnelles donc la dynamique du processus par lequel
l'individu, le groupe ou l'organisation acquièrent une compréhension de leur comportement et du contexte,
chacun à son niveau d'intégration.
Les représentations comprises dans un processus dynamique font appel à l'apprentissage et donc à un changement, d'une manière ou d'une autre, par rapport à un état antérieur (voir § 8.3.).
L'espace de représentation de
l'Ítre humain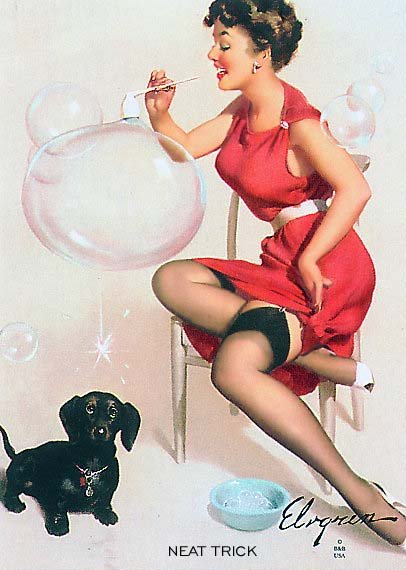
L'espace de représentation chez l'être humain est une sorte "d'écran virtuel" où se projettent les images venant de nos perceptions, de notre mémoire et de notre imagination. Le mot image a ici un sens général, il couvre aussi bien les représentations visuelles que les représentations auditives, olfactives gustatives et sensitives ainsi que les sensations internes (cénesthésiques). Ces images subissent des altérations le long de leur parcours, altérations dues aux sens eux-mêmes (seuils, erreurs et saturation de perception), altérations dues aux mécanismes internes de la mémoire, aux diverses tensions de la structure et aux déformations dues à l'imagination. Toutes ces altérations ont été rassemblées sous le terme de "filtres".
Limitations
La façon dont les images se structurent dans l'espace de représentation donne à l'ensemble un volume, une densité et une fluidité qui correspondent aux aspects de la personnalité de l'individu : ses tensions, ses blocages, mais aussi ses possibilités d'ouverture. Il est plus ou moins facile de se "promener" dans son espace de représentation d'une part, d'où les notions de fluidité et de volume et d'autre part il est plus ou moins facile d'y projeter des images claires venant d'expériences diverses accumulées, d'où la notion de densité. Dans la vie courante, notre espace de représentation se restreint aux dimensions de notre corps, il reste en quelque sorte limité par les blocages de notre structure.
Fig. 8.2.2. Les limitations de l'espace de représentation
Élargissement
C'est en clarifiant notre perception, en affinant l'utilisation de notre mémoire, en prenant du recul vis à vis des constructions de l'imagination et en ouvrant notre vie vers des expérimentations nouvelles qu'il est possible de donner une autre dimension et une autre qualité de contenu à l'espace de représentation, une autre dimension et une autre qualité à notre "personnalité". Par l'élargissement de son champ de conscience, l'individu se décolle de ses images internes, il s'éloigne de ses noeuds de tension, et il peut ainsi voir de "l'extérieur" les phénomènes qui l'habitent. On parle alors de fusion entre le monde intérieur et le monde extérieur.
Fig. 8.2.2/1 L'élargissement de l'espace de représentation
Le système de représentation de l'organisation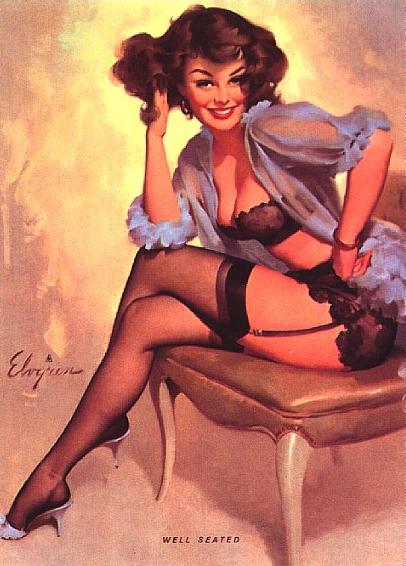
La problématique de la représentation est et restera à la base de toutes théories et pratiques concernant les organisations, donc en particulier de la théorie et de l'analyse des systèmes.
L'analyste, s'il n'y prend garde, risque de considérer sa représentation comme objective et "naturelle" oubliant les conditions spécifiques de sa genèse et ne se souciant plus de sa "distance au réel". Les systémiciens ne sont pas seuls dans ce cas, discours et théories sur l'entreprise et l'administration fusent de partout générant des pratiques , des outils de gestion, de contrôle, de traitement de l'information qui sont appliqués aux organisations. Tout ceci reproduit, propose ou cherche à imposer chacun une représentation particulière quelque soit le thème (direction par objectifs, bases de données, relations humaines, prévisions budgétaires, examen des écarts, etc...).
Cette représentation particulière qui va prendre les traits et jouer le rôle du réel n'informe pas sur ses origines et ses conséquences et moins encore sur son système de valeurs, finalités retenues et rapports de forces sous-jacents. Elles est présentée comme "allant de soi" en référence soit à des repères idéologiques, historiques, notions globales faisant appel à la mémoire collective (service public, responsabilisation, motivation des hommes, l'information, l'enrichissement et la revalorisation du travail) soit , dérivant de lois supposées de l'organisation (unité de commandement, masse critique, taille humaine, échelle de motivations, etc...).
Les représentations dominantes sont stables encore aujourd'hui dans les organisations (profit, croissance, progrès, économie d'échelle, utilisation des compétences, libération de l'homme, etc...) , cependant, on observe à l'heure actuelle des conflits de représentation qui influencent les organisations et leur devenir (ex. : les écologistes dont les représentations ébranlent des industries consommatrices d'énergie ou polluantes, etc...). Autre conflit, les filiales, agences, usines, collectivités locales dont le personnel émet des représentations adaptées au tissu socio-économique local alors que vu du siège social distant ou de l'administration centrale, ils ne sont perçus que comme extrémité du processus ou de la chaîne de production.