Dans la sphère conceptuelle et organisationnelle, Yves TABOURIER évoque les joies de la modélisation de l'activité de l'entreprise et nous en explique le pourquoi et le comment à l'aide du module "Business Analysis" (AGL de la société MEGA International).
Les cinq bonnes raisons de modéliser l'activité de l'entreprise sont les suivantes :
expliquer son fonctionnement (approche dynamique par rapport à la statique de l'organigramme),
concevoir son système d'information (intégrant les objectifs, les besoins, son fonctionnement en interactions avec l'environnement utilisant les TIC),
mettre en évidence ses risques (d'origine interne dysfonctionnements générés par son propre processus et d'origine externe par l'interaction de son système plongé dans un environnement),
réfléchir à des changements de son organisation (support de diagnostic, outil thérapeutique de remède aux défaillances détectées et de pronostic pour les investisseurs et assureurs),
concevoir sa stratégie (éclairé d'une compréhension des mécanismes d'interaction avec son environnement administratif, financier, social, technique et culturel, le management repositionnera l'entreprise dans cet environnement .
Les trois façons de modéliser l'activité de l'entreprise sont les suivantes :
Les modèles globaux
Les modèles globaux son utilisés pour supporter les réflexions qui englobent généralement l'ensemble de l'entreprise en montrant l'interaction de ses sous-systèmes afin de réfléchir à l'opportunité et à la priorité de projets stratégiques, organisationnels ou de systèmes d'information à mettre en place.
L'approche sera différente selon la culture et les objectifs des responsables, l'éclairage sera fonction des sous-systèmes repérés tels des acteurs responsables (l'équipe dirigeante), des domaines d'activité (les fonctions par nature), des processus (la chaîne des actes de l'entreprise, les tenants et aboutissants), des applications (ensembles logiciels du SI).
Les modèles globaux identifient les éléments suivants :
la carte des acteurs de l'entreprise,
la carte des domaines de l'entreprise,
la carte des processus,
la carte des applications.
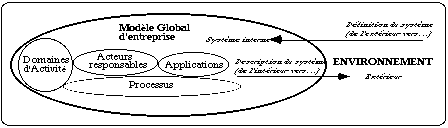
Fig. 5.2.2/2 Schéma des sous-systèmes des Modèles globaux
La carte des acteurs de l'entreprise
Elle montre les acteurs principaux, les partenaires de l'entreprise, et les principaux flux échangés entre eux et d'autre partenaires.
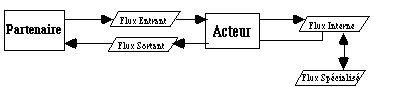
Fig. 5.2.4/1 Schéma de principe de la carte des acteurs principaux
Nota :Les acteurs principaux généralement bien identifiés et apparaissent dans l'organigramme, les partenaires principaux sont également identifiés et les flux observables. Dans l'étude des SI, elle prend le nom de "MOA" (Modèle Organisationnel d'Activité) et les flux des "Messages".
La carte des domaines de l'entreprise
Elle ressemble à la première mais elle montre les activités dans une logique métier, et les principaux flux échangés entre eux et d'autre partenaires.
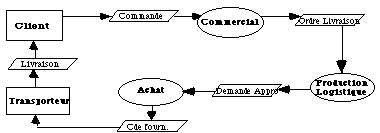
Fig. 5.2.4/1 Schéma de principe de la carte des domaines de l'entreprise
Nota :
La carte d'un domaine économique est une variante servant à la réflexion sur le positionnement de l'entreprise (externalisation ou intégration d'une activité de partenaire) . Dans l'étude des SI, elle prend le nom de "MCA" (Modèle Conceptuel d'Activité),et les flux des "Messages".
La carte des processus
Elle est à la mode grâce au BPR. La carte des processus est destinée à donner une vue d'ensemble des principaux processus de l'entreprise. (les domaines sur un plan abstrait, les acteurs sur un plan plus concret, constituent un regroupement intemporel d'activités, de tâches ou d'opérations dont on ne perçoit pas forcement l'enchaînement. Les processus eux correspondent à une succession de tâches reliées par des liens qui les déclenchent. Lorsqu'on cherche à définir un processus de l'extérieur "de... à..." est la bonne formulation.
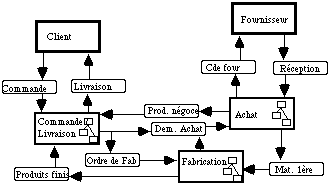
Fig. 5.2.4/2 Schéma de principe d'un processus
Sur cette carte apparaissent les flux de valeur et de richesse produits par l'entreprise, se traduisant sous la forme de ratios entre des flux entrants et sortants du processus de production (le délai commande / livraison - .le rendement / matière ou le délai E / S de fabrication "en cours") .C'est un instrument très puissant pour détecter les gisements d'économie et d'efficience dans les organisations soit en améliorant le processus défectueux soit en le remplaçant purement et simplement par un autre processus plus efficace (voir le § 6 - BPR).
La carte des applications
Cette dernière carte globale est destinée à mettre en évidence les ensembles logiciels dont disposent acteurs, domaines et processus pour la partie automatisée du Système d'Information. (l'on passe ici des niveaux "abstrait" et "concret" pour nous intéresser au niveau logique. Plus précisément, nous passons des modèles Conceptuel (MCA) et Organisationnel (MOA) d'Activité qui nous ont permis de décrire le fonctionnement de l'entreprise dans ses aspects managérial, informationnel et opérationnel pour nous intéresser à la partie logiciel dans son seul aspect informationnel).
Les modèles de flux
Les modèles de flux montrent la structure (l'éclairage statique) d'un sous-système particulier de l'entreprise (des acteurs dirigeants, des domaines) ou participant au sous-système (processus ou application) ainsi que les échanges qu'ils ont entre eux et avec l'environnement extérieur dans le cadre de ce sous-système.
Les modèles de flux identifient les éléments suivants :
les flux entre Acteurs ,
les flux entre Activités,
les autres flux entre sous-systèmes.
Les flux entre Acteurs
C'est le modèle "Concret" des flux observables entre acteurs. Dans les études de SI ils sont appelés "MOC" (Modèle Organisationnel de Communication).
Les flux entre Activités
C'est le modèle "Abstrait" des flux observables entre activités (suivant que nous avons affaire à un domaine, un acteur ou un processus. Dans les études de SI, ils sont appelés "MCC" (Modèle Conceptuel de Communication).
Les autres flux entre sous-systèmes
Les modèles d'applications se décomposent en sous applications au moyen des outils qu'ils comportent.
Les modèles de niveaux mixtes : lorsque l'on étudie un système, on est amené à en faire des modèles conceptuels, organisationnels et logiques.
Par exemple : un système à étudier est formé d'activités (niveau conceptuel), mais que les flux échangés le soient avec tel acteur (niveau organisationnel), voire avec telle application (niveau logique), alors le modèle semble mélanger les niveaux mais le système étudié sera lui, d'un niveau homogène.
Ce type de modèles sert de support efficace à la réflexion créative sur les modifications à apporter.
Les modèles de processus
Le modèle de déroulement de processus (traitement) montre quant à lui comment s'enchaînent les étapes successives d'un processus (l'éclairage dynamique).
Ce type de modèle fait apparaître la logique interne et les risques de dysfonctionnement, il est utile dans la critique argumentée pour valider les nouvelles solutions avant de les mettre en place.
Les modèles de déroulement des processus identifient les éléments suivants :
les opérations d'une activité,
les modèles abstraits de déroulement (MCT),
les modèles concrets de déroulement,
la politique de ressources humaines.
Les processus
Les processus représentent les chaînes d'opérations qui transforment une entrée (information, matière) en une sortie (produit ou service) destinée à un client (interne ou externe) à l'entreprise. L'architecture est la colonne vertébrale du système qui structure les liens entre les différentes entités de l'entreprise et l'activité des acteurs. Le management communique les objectifs, une évaluation des résultats est réalisée par un système de mesure efficace. La culture, souvent de type fonctionnelle (verticale), tend à devenir de type métier (horizontale).