 Le travail en équipe est un thème qui fait couler beaucoup d'encre. Nous apporterons notre
contribution par le développement de notre point de vue . L'approche que nous allons adopter et
le contenu peuvent surprendre, cependant ils partent toujours de l'expérience vécue et
d'observations individuelles et personnelles confrontées à celles des autres membres
participant aux opérations.
Le travail en équipe est un thème qui fait couler beaucoup d'encre. Nous apporterons notre
contribution par le développement de notre point de vue . L'approche que nous allons adopter et
le contenu peuvent surprendre, cependant ils partent toujours de l'expérience vécue et
d'observations individuelles et personnelles confrontées à celles des autres membres
participant aux opérations.
Les conditions pour un bon travail en équipe sont notamment la recherche de l'affinité entre les participants mais également l'aptitude des participants à détendre la relation. Une constante apparaît tout au long du déroulement du travail d'équipe, comme un fil conducteur, c'est la nécessité de maintenir la direction de la pensée dans une ligne convergente.
Nous distinguerons trois étapes dans le travail en équipe, les hypothèses (différenciation), les apports (ou complémentation) et la synthèse.
Les hypothèses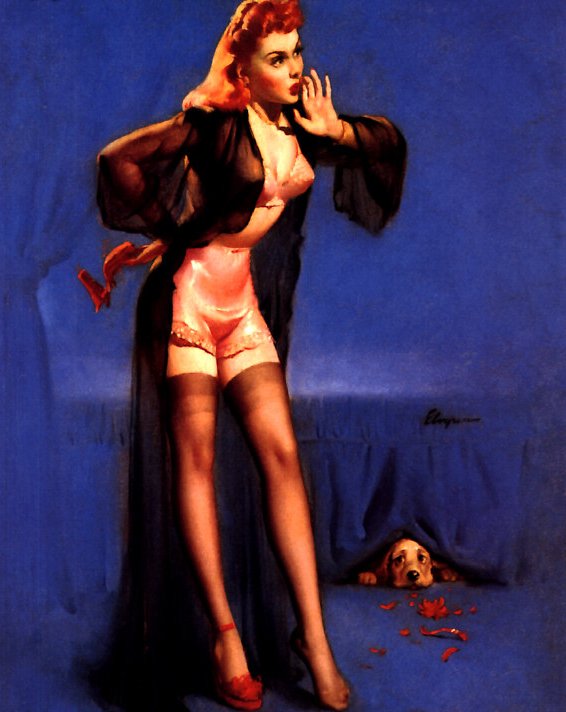
La première étape du travail en équipe est le lancement d'hypothèses qui se structurent autour d'un thème. Ce point de départ s'effectue à partir de la fixation d'un point d'intérêt (motivation) afin d'encadrer le travail en équipe (sorte de ligne mentale à maintenir). Il est à noter qu'une hypothèse n'a besoin d'aucune démonstration. C'est un lancement d'idées sans fondement, ceci afin de laisser libre court à la production et au maniement des idées (cf brainstorming). Une grande liberté imaginative est offerte aux participants lors de cette première étape, ceci dans le cadre de la "ligne mentale" fixée au tout début.
Nous parlons d'hypothèses mais il semble que l'intérêt soit en fait mis sur ce qui se passe entre les participants, la détente (dans le meilleur des cas) ou la tension (à défaut) dans la relation. A ce stade, le travail d'équipe montrera la volonté des intervenants à échanger ou bien à entrer en confrontation lors de l'échange des différents points de vue provoquant des tensions au sein de l'équipe. Une fois l'intérêt fixé sur un thème par le lancement d'hypothèses, la matière première ainsi produite sera complétée et synthétisée dans les deux étapes suivantes.
Les apports
L'apport représente la seconde étape du travail en équipe. Elle consiste en l'apport de matière autour de l'hypothèse formulée lors de l'étape précédente. Cette étape demande plus de travail que la première et ne bénéficie pas du même niveau de liberté. L'étude des relations entre les différents éléments ainsi qu'avec leur environnement font partie de cette étape. La difficulté à ce stade du travail en équipe réside principalement, pour chaque participant, à identifier les tensions physiques générées par le travail intellectuel de réflexion et d'échange avec les autres, de détendre ces tensions musculaires pour maintenir la fluidité du travail. La production des éléments par chacun doit être vue comme un réel apport à l'enrichissement commun. La production des éléments mis en relation a permis, à ce stade du travail, d'enrichir l'hypothèse de départ, d'affiner la matière première et de la résumer.
La synthèse
Le travail de synthèse représente la troisième étape du travail en équipe. C'est une réelle mise en dynamique des éléments, de leur relations avec l'environnement et des différents niveaux de point de vue où l'on se place dans cette dynamique.
Le jeu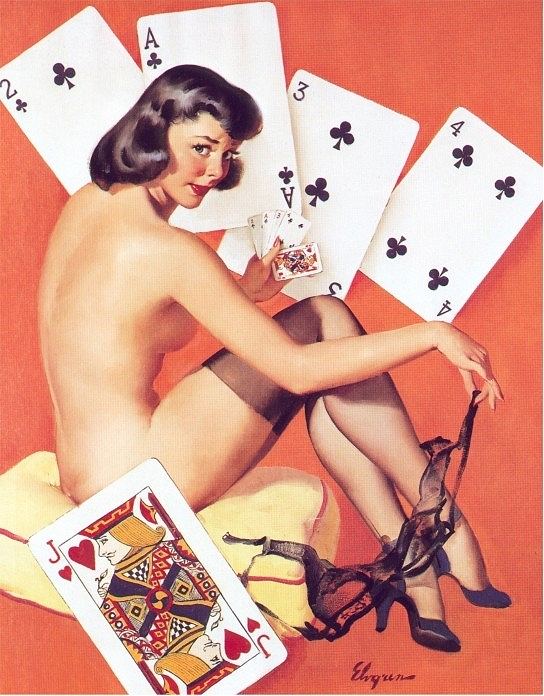
Le jeu est l'instrument que les hommes ont élaboré pour régler leur coopération nous dit CROZIER . C'est l'instrument essentiel de l'action organisée conciliant tout à la fois la liberté et la contrainte (les règles).
S'il s'agit d'un jeu de coopération, comme c'est toujours le cas dans une organisation, le produit du jeu sera le résultat commun recherché par l'organisation. Ce résultat n'aura pas été obtenu par la commande directe des participants mais par l'orientation qui leur aura été donnée par la nature et les règles de jeux que chacun d'eux joue et dans lesquelles ils cherchent leur propre intérêt. Le jeu est un "construit humain" pour reprendre une expression de CROZIER.
C'est en jouant que l'on apprend, mais au fil des années la conscience du jeu disparaît progressivement des activités de l'adolescent ou de l'adulte. Nous savons maintenant, grâce à la neurochimie, qu'il doit exister un équilibre entre Attention et Plaisir pour qu'une protéine de synthèse (la bêta-carboline), soit produite au dosage adéquat pour faciliter la mémoire et l'apprentissage. Le jeu n'est pas futile, loin de là, son utilisation dans l'entreprise est formateur, voire même très sérieux et vécu comme tel.
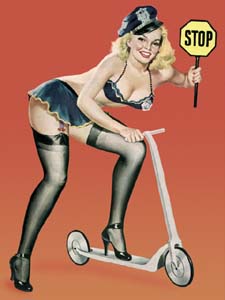
Les règles du jeu
Dans tous les jeux il existe des règles. Celles-ci nécessitent d'être respectées pour que le jeu puisse se dérouler entre les partenaires et que la confiance et l'envie de jouer s'installent entre les acteurs du jeu. Pour que le jeu se déroule dans de bonnes conditions, nous identifions trois règles de bases :, le tonus, la propreté et la métrique (interne et externe).
Le tonus

C'est maintenir un niveau d'énergie et d'intérêt constant pour le jeu. Il exige la détente et l'attention. Il correspond à un état de la structure de la personne et lui permet de lancer des actes unitifs (penser, sentir et agir dans le même sens). Développer les actes d'attention.
La métrique interne et externe
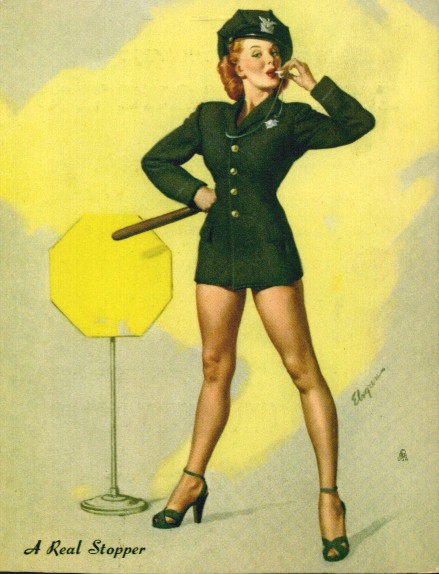
Il n'y a pas de métrique sans tonus et pas de métrique externe sans métrique interne.
La métrique consiste à être attentif aux équilibres et observer en interne ce que produit le jeu (état de conscience) et à mesurer son action (contrôler d'éventuels excès). La métrique externe est liée aux effets produits sur son environnement et de manière plus générale à la sociologie.
La propreté
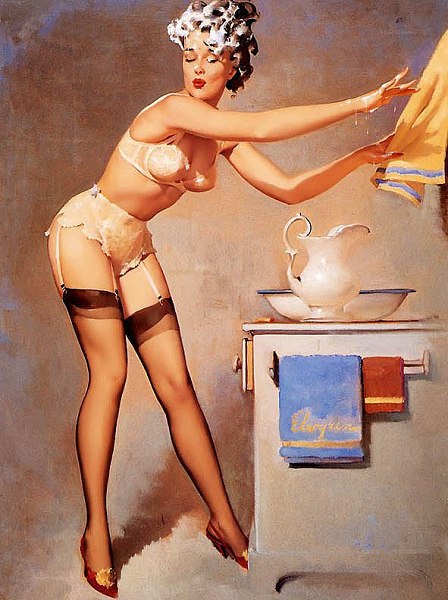
C'est le respect des règles définies et / ou acceptées par l'ensemble des joueurs. Dans la vie de tous les jours, il existe ce que l'on appelle "le facteur de dissimulation" (ne pas jouer le jeu tout en faisant semblant) ; il dissimule l'être humain derrière l'emprise de la personnalité (un rôle est un facteur de dissimulation). Dans le jeu, ce facteur est un écran qui est mis devant les règles.